45 Jérôme Ferrari (et moi) !
(Toutes les photos de phare de cette chronique - dues au talent de Zahira Dris/Zaz la Bônoise - sont une tentative désespérée pour éclairer les zhéros de Ferrari, perdus dans un brouillard opaque (camarades) opaque opaque opaque !)
Je suis coupable. Je suis coupable de me sentir coupable. Déjà. Je croirais presque que je n’y peux rien puisque ce sentiment m’a été inculqué, inoculé, dans ma plus tendre enfance. Je suis donc tombé dedans tout petit. Il fait partie de ma constitution. Ce n’est pas un corps à moi étranger. Il m’est par conséquent difficile de m’en débarrasser ou même de le contrer. Il agit sans coup férir, en douceur et profondeur, à l’insu de mon plein gré, expression cyclistique reconnue. Je suis coupable d’avoir été jeune, coupable d’être vieux, coupable de respirer, coupable pour l’autre cloué sur sa croix de bois, croix de fer, si ça se trouve j’irai en enfer, sans avoir rien demandé, rien fait de mal, coupable de la misère, encore coupable si jamais je devenais riche, coupable de ne pas être né ici, et je pourrais continuer à l’infini. Donc, j’arrête. C’est comme les points qui constituent une ligne.
Il y a bien mon esprit de contradiction pour s’y opposer un peu, mais à chaque fois qu’il s’interpose, le retour de bâton est fulgurant. Tout ceci peut vous paraître complexe ou incongru, je vous sens perplexe, mais est en fait très simple. C’est une pure réalité. C’est une mécanique parfaitement huilée qui fonctionne sans qu’on ait besoin de la retaper.
Pour illustrer mon propos comme on dit dans les colloques que je ne fréquente plus depuis…j’ai oublié, je vous offre un exemple qui est résolument sans importance. Exemple donc qui n’a aucune importance. J’aimais bien le mec (l’écrivain pardon) qui s’appelle Jérôme Ferrari. Ce n’est pas tant qu’il ait une belle carrosserie, quoique, j’aimais bien ce que les journaux rapportaient sur sa vie, puisque je ne le connaissais pas, je veux dire personnellement. Ce n’est pas un ami de ma famille, ce n’est pas un ami de mes amis, je ne connais pas de Corse, ce n’est pas un écrivain édité par le même éditeur que le mien, puisque je n’en ai point. Encore une mauvaise raison pour me sentir coupable. Coupable de ne pas avoir décroché un éditeur.
Les médias en ont fait un prof de philo d’origine corse, né à Paris quand même, parlant corse, ayant traduit le formidable roman (Morituri) de son compère corse Marco Biancarelli, qui lui, écrit en corse (cela je le savais depuis ma chronique n°9 et 15), parti enseigner la philosophie en Algérie, puis à Abu Dhabi. Tout cela me semble complètement à contre-courant. En tout cas, je m’en suis persuadé. Cela me plaisait et me donnait un a priori positif sur ses romans. Et puis, patatras !, il obtient le Goncourt ! Alors là, mes agneaux, mon esprit de contradiction ne s’est pas fait prier et Ferrari chuta illico (plus vite que Rome) dans mon thermomètre affectif. La fièvre de tous les jours était retombée à zéro (vous allez voir que zéro ici n’est pas innocent). C’était direct (voir chronique n°- à vous de trouver- le premier qui trouve aura un cadeau) et sans appel. Je suis comme ça. Mes rares amis vous diront que je suis fait d’un seul bloc (mais pas du tout identitaire, ne vous imaginez surtout pas le contraire, je reste par le hasard et le désir de ma vie, d’ici et d’ailleurs). Par la suite, la satanée culpabilité s’est mise à cheminer par devers moi comme une chenille processionnelle qui engloutit tout ce qu’elle trouve sur son chemin, tous les romans que j’aurais pu, que j’aurais dû, que j’aurais eu envie de lire.
En farfouillant dans ma librairie préférée pour dénicher un traité de philo (j’en parlerai peut-être) en plus d’un roman, deux bouquins en somme qui seraient suffisamment fort pour me prendre en entier, me faire décoller, me passionner en me faisant oublier un instant notre triste réalité, c’est alors que je tombai sur mon pote (virtuel) Ferrari. Un roman antérieur à l’obtention de son prix. Je l’achetai les yeux fermés, mes agnelles. Je n’eus de cesse de me dépêcher tant que je ne l’avais commencé. Si je ne venais pas d’être opéré, j’aurais couru sans vergogne dans la rue pour rentrer au plus vite au bercail. Regardez ce vieux qui court dans la rue sans vergogne, on dirait qu’il se prend pour un djeun, auraient aussitôt clamé les autres vieux que j’aurais dépassés. Je devais en avoir le cœur net. Mon espoir n’a pas été déçu mais il a été torturé de toutes les manières. Ferrari ne nous fait pas oublier la triste réalité, il nous plonge dedans, au moins jusqu’au cou. Ses zhéros errent dans un brouillard philosophiquement opaque. Je devais l’avoir bien accroché déjà pour lire des phrases qui m’assassinent personnellement, sans même qu’il me connaisse, le salaud, en une sorte de vengeance par anticipation, à partir des mots de Jorge Luis Borgès sur « l’inconcevable univers » dans el Aleph. Ferrari écrit : À cause de cette phrase, Béatrice avait renoncé à la dangereuse tentation qui guette toute personne raisonnablement lettrée, la tentation d’écrire. Elle avait trouvé là quelque chose de plus beau, de plus intime et de plus universel que tout ce qui, elle le savait, aurait pu naître de sa plume. Avec ses phrases définitives, Ferrari m’assassinait pour toujours (assassiner c’est toujours pour toujours mon pauvre vieux) et transformait mon écriture de raisonnablement lettré en inutile bavardage. Je ne peux pas lui donner entièrement tort. Malgré tous mes efforts pour laisser des traces, je ne laisserai que des traces de m... ! Encore coupable. Voilà donc que cet irresponsable me renvoie sans rémission à ma solitude éternelle structurelle. Inconcevable univers. Je m’étais jeté corps et âme dans l’écriture et voilatipa qu’il m’en exclu irrémédiablement. Pire, j’ai même payé pour lire ça ! Et en partie à lui ! Mais pour qui se prend-il donc, cet arrogant, cet agrégé de philo, ce Corse iconoclaste, cet écrivain arabe qui cite la Fatiha en début de son pensum, ce type qui se permet de nous balancer des phrases en des langues inconnues de nous sans même prendre la peine de les traduire (sauf la Fatiha justement). Il nous prend pour qui ? Nous n’avons pas le bac des langues à passer quand même ! Justement, je crois qu’il se prend pour un Corse. Et quand on connaît un peu (comme moi) la beauté époustouflante de cette île sanguinaire, on comprend ce que peut être la corsitude comme malédiction. Ferrari nous la dévoile encore davantage dans ses personnages à l’apparence métropolitaine continentale, au goût de la France scolaire tiédasse, sauf que non, décidément, les racines sont pourries. Ils voient des souches inquiétantes au fond des lacs. Mais c’est toujours l’inconcevable univers de Borgès qui suscite son angoisse, et c’est, par définition, universel. Le reste n’est que bavardages. Ses zhéros n’y arrivent pas et ne savent pas pourquoi, comme la Corse on dirait. Sacré Corse ! Est-ce que la beauté suffit à pardonner ? Non ! Coupables, je vous dis.
Je déclare solennellement Jérôme Ferrari coupable de nous entraîner dans des profondeurs insondables de l’âme humaine, sans bavardage aucun.
Tout cela, bien sûr, je l’ai vécu et, dans un sens, pensé, mais aussi, en même temps, je ne peux pas dire que je l’ai pensé, pas plus qu’on ne dirait de quelqu’un qui épelle correctement un mot dont il ne connaît pas le sens qu’il parle. Quelqu’un, je l’ai dit, m’a appris à prononcer les mots, sans me donner de leçon, sans rien expliquer, sans savoir non plus le premier mot de cette histoire qui est d’abord la sienne, pourtant, parce que c’est lui qui m’a appris. Lui aussi, il a éclairé sans le vouloir quelque chose qui n’est qu’à moi, et il m’a fait comprendre que c’était cela, une rencontre. Et moi, donc, je dois bien éclairer quelque chose en lui et je sais que je le fais mais je ne sais pas ce que j’éclaire. Peu de temps après l’avoir rencontré, nous discutions dans le bar où nous nous retrouvons d’habitude, et puis j’ai soudain eu envie de faire un geste que je ne fais jamais ; je voyais ses mains sur la table, comme des objets encombrants et inutiles, et il y avait là soudainement une telle puissance émotive, que j’ai posé mes deux mains sur les siennes, bien à plat, comme pour recouvrir le plus de surface possible. C’est un geste que je fais tout le temps, maintenant, un geste qui fait partie de moi, qui émane de moi, ou plutôt non, pas de moi, non, mais du point d’intersection où nous nous rencontrons. Ce jour-là, comme presque tous les jours, il semblait complètement à côté de la plaque, mais quand je l’ai touché, il en fut comme saisi par la grâce, la joie même (et c’était terriblement délicieux de voir ce qu’un de mes gestes, un seul geste simple et bêtement spontané pouvait bouleverser comme ça)
Jérôme Ferrari, Aleph Zéro, Babel (Albiana 2002)


/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F9%2F4%2F941260.jpg)
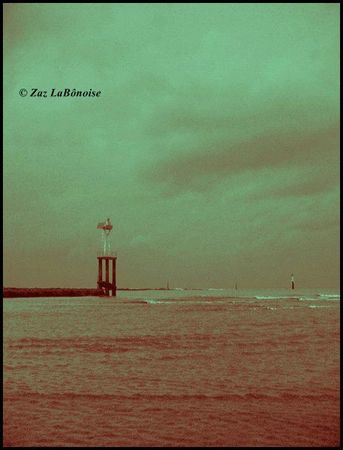







/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F80%2F60%2F1043019%2F81222996_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F17%2F55%2F1043019%2F130367784_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F36%2F62%2F1043019%2F129870685_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F12%2F83%2F1043019%2F129824718_o.jpg)